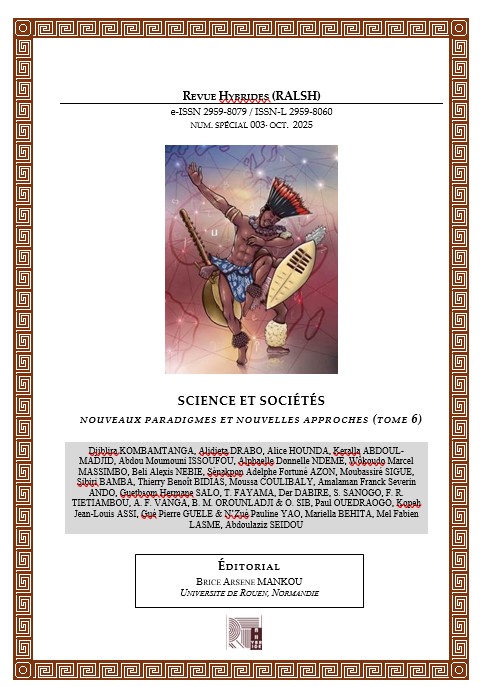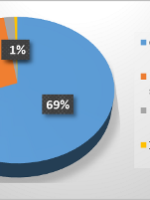Revue Hybrides (RALSH)
e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060
Num. spécial 003, Oct. 2025
La plurivocalité au cœur de la mise en scène énonciative du discours épique de Djado Sékou
Plurality in the heart of the enunciative staging of Djado Sékou’s epic discourse
Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger
Email : issoufou.abdoumoumouni@udh.edu.ne
Orcid id : https://orcid.org/0009-0004-7644-8861
Résumé : Dans l’espace culturel Songhay-Zarma (au Niger), la dramatisation du discours épique est du ressort des conteurs professionnels. Elle peut être faite avec un seul narrateur. Mais dans certaines circonstances, il est possible que deux énonciateurs associent leurs voix pour déclamer le récit, ce qui augure alors la perspective d’une énonciation polyphonique. Celle-ci est la spécialité et la particularité du djassaré nigérien, Djado Sékou dans ses prestations épiques. Le présent article a pour objectif d’analyser le travail collaboratif entre Djado Sékou et Karimou Saga qui s’associent pour produire le discours épique. La méthodologie adoptée dans ce travail a consisté, d’abord, à la constitution du corpus servant d’appui à l’analyse. Ce corpus est composé de trois récits épiques dont le premier est extrait de Récits épiques du Niger, Tandina (2004) et les deux autres sont tirés de Récits épiques du Niger, Textes de Djéliba Badjé et Djado Sekou, Issa Daouda (2011). Ensuite, elle s’est attelée à la recherche documentaire appropriée au développement de la thématique abordée dans cette réflexion afin de soutenir l’argumentation y afférente. L’étude dévoile la cohabitation harmonieuse entre deux acteurs énonciatifs au statut et aux fonctions différents mais complémentaires dans la mise en scène du discours épique.
Mots-clé: Plurivocalité, Mise en scène, Discours épique, Enonciateur principal, Enonciateur secondaire.
Abstract : In the cultural area Songhay-Zarma (in Niger), the dramatisation of epic discourse is the responsibility of professional storytellers. It can be performed by a single narrator. However, in certain circumstances, two narrators may join forces to tell the story, thus opening up the possibility of polyphonic narration. This is the peculiarsty and distinctive feature of the Nigerien djassaré, Djado Sékou, in his epic performances. The aim of this article is therefore to analyse the collaborative work between Djado Sékou and Karimou Saga, who join forces to produce epic discourses. The methodology adopted in this work consisted, first, of compiling the corpus used to support the analysis. This corpus consists of three epic tales, the first of which is taken from Epic Tales of Niger, Tandina (2004), and the other two from Epic Tales of Niger, Texts by Djéliba Badjé and Djado Sekou, Issa Daouda (2011). She then undertook documentary research appropriate to the development of the theme addressed in this reflection in order to support the related argumentative development. The study reveals the harmonious coexistence of two enunciative actors with different but complementary statuses and functions in the staging of epic discourse.
Keywords: Plurivocality, Staging, Epic discourse, Main enunciator, Secondary enunciator.
Références bibliographiques
Bakhtine, M. (1984). Esthétique de la création verbale. Gallimard.
Bornand, S. (2009). Une narration à deux voies, exemple de coénonciation chez les jasare
songhay-zarma. Cahiers de littérature orale, 65, 39-63. http:// clo.revues.org/1104 consulté le 30-04-2014
Charaudeau, P. & Maingueneau, D. (2002). Dictionnaire d’analyse du discours. Seuil.
Ducrot, O. (1984). Le dire et le dit. Minuit.
Finnegan, R. (1978). The Penguin Book of oral poetry. Allen Lane.
Genette, G. (1972). Figures II. Éditions du Seuil.
Issa Daouda, A. (2011). Récits épiques du Niger, Textes de Djéliba Badjé et Djado Sekou.
Université Abdou Moumouni.
Kerbrat-Orecchioni, C. (1996). La conversation. Seuil.
Mbow, F. (2010). Enonciation et dénonciation du pouvoir dans quelques romans négro-
africains d’après les indépendances [Thèse de doctorat]. Université Cheikh Anta
Diop de Dakar. https : //theses. hal. science// consulté le 19-12-2019
Perrin, L. (2004). La notion de polyphonie en linguistique et dans le champ des sciences du
langage. Questions de communication, 6, 265-282. //Doi.org/10.4000/Questions de communication445
Saibou Adamou, A. (2014). Identités et parole poétique chez les Songhay-Zarma. Éditions
Gashingo.
Seydou, C. (2008). Genres littéraires de l’oralité : identification et Classification. In
Baumgardt U. & Derive J. (Eds.), Littératures orales africaines. Perspectives théoriques et méthodologiques (pp.125-176). Karthala.
Sow, A. (2019). Le héros épique dans la chanson traditionnelle et contemporaine en peul,
poulâr du Foûta Tôro (Sénégal, Mauritanie). Linguistique. Institut National des
Langues et Civilisations Orientales.
SY, H. (2020). Enfants de paysans pauvres à l’Université publique. Auto-exclusion des
Exclus de l’intérieur. Éd. L’Harmattan.
Tandina, O. (2004). Récits épiques du Niger. Université de Picardie Jules-Verne.
Tandina, O. (2012). La parole épique dans les récits d’un griot du Niger : Djado Sekou. Studia
Africana, 23, 101-129. https : //www.africabid.org/rec.php ?RID//
Todorov, T. (1981). Mikhaïl Bakhtine – Le principe dialogique suivi de Ecrits du Cercle de
Bakhtine. Editions du Seuil.
Zumthor, P. (1984). Introduction à la poésie orale. Seuil.