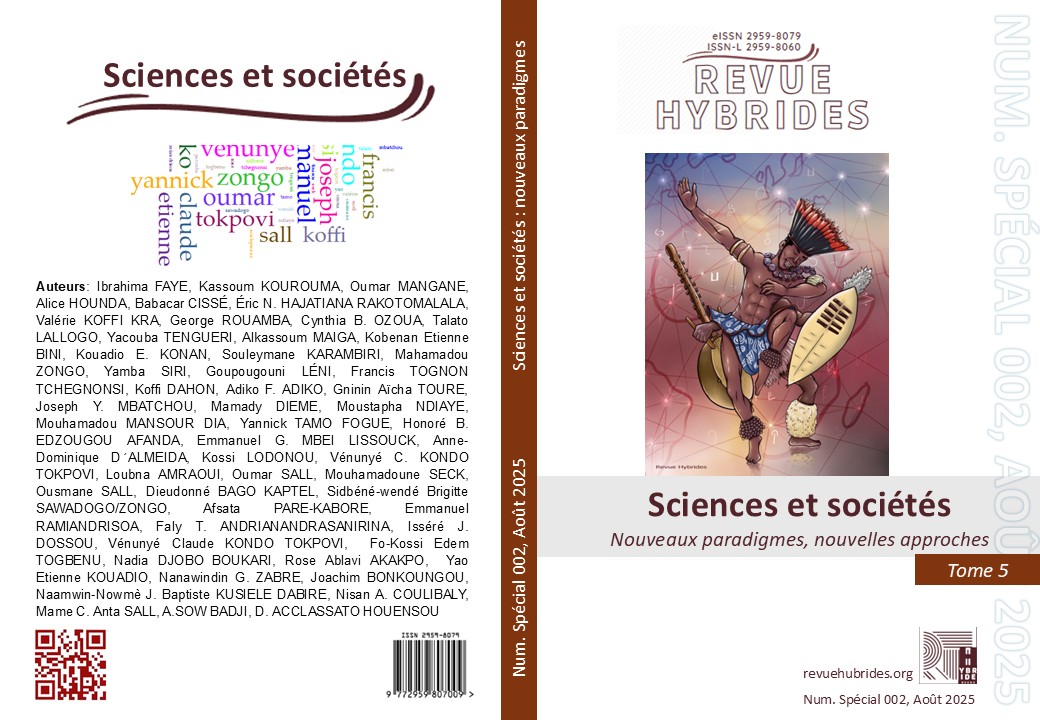IFAN – Ch. A. Diop, Dakar, Sénégal
Email : ibrahima42.faye@ucad.edu.sn
Orcid id : https://orcid.org/0009-0006-7427-8437
Résumé : La version populaire de la musique sénégalaise peut être interprétée comme le prolongement du discours poétique wolofal. Ses références symboliques et son architecture stylistique ont épousé, durant les cinquante dernières années, les contours des œuvres des orateurs qui se sont plus fait connaître du grand public à travers ce support de communication. Cette étude, qui est au carrefour de ces deux expressions artistiques, décortique, d’une part, les logiques justifiant l’adoption et l’adaptation des ressources patrimoniales immatérielles wolofal par l’art musical populaire, et analyse, d’autre part, les procédés rhétoriques facilitant le dialogue harmonieux entre ces deux formes de discours chanté. La construction du sens du message des différents performateurs dont les textes sont étudiés dans cette réflexion et la reconstruction du dispositif d’énonciation, mettant en scène le locuteur et l’allocutaire, dans un univers discursif imaginé et marqué, exigent de recourir, dans ce travail, aux théories de l’ethnolinguistique, de l’intertextualité et de l’énonciation afin de mieux éclairer l’examen des rapports d’influence que ces créativités artistiques entretiennent.
Mots-clé: Conversion poétique, Musique populaire sénégalaise, Productions chantées, Résurgence, Wolofal.
Abstract: The popular version of senegalese music can be interpreted as an extension of the wolofal poetic discourse. Its symbolic references and stylistic architecture have embraced, over the last fifty years, the contours of the works of speakers who have become more known to the general public through this medium of communication. This study, which is at the crossroads of these two artistic expressions, dissects, on the one hand, the logics justifying the adoption and adaptation of intangible heritage resources wolofal by popular musical art, and on the other hand, analyzes rhetorical processes facilitating the harmonious dialogue between these two forms of sung speech. The construction of the meaning of the message of the different performers whose texts are studied in this reflection and the reconstruction of the enunciation device, featuring the speaker and the speaker, in a discursive universe imagined and marked, require the use, in this work, of ethnolinguistic theories, intertextuality and enunciation in order to better illuminate the examination of the relationships of influence that these artistic creativity maintain.
Keywords: Poetic conversion, Popular senegalese music, Sung productions, Resurgence, Wolofal
Références bibliographiques
Amossy, R. (2010). L’argumentation dans le discours. Armand Colin.
Benga, A, N. (2002). Dakar et ses tempos. Significations et enjeux de la musique urbaine (c. 1960 – années 1990). In M.-C. Diop (Ed.), Le Sénégal contemporain (pp. 289–308). Karthala.
Bop, B. (2015). Tout pour Cheikh Béthio et Serigne Saliou. https://www.enqueteplus.com/content/profil-mouhamed-niang-chanteur-tout-pour-cheikh-b%C3%A9thio-et-serigne-saliou. (Consulté le 18 décembre 2024 à 18h 00mn).
Calame-Griaule, G. (1970). Pour une étude ethnolinguistique des littératures orales africaines. Langages, 18, 22-47. https://www.persee.fr/doc/lgge_0458-726x_1970_num_5_18_2026.
Cissé, M. (2006). Parole chantée ou psalmodiée wolof. Collecte, typologie et analyse des procédés argumentatifs de connivence associés aux fonctions discursives de satire et d’éloge. Thèse de doctorat, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. http://bibnum.ucad.sn/viewer.php?c=thl&d=THL-1083.
Charaudeau, P. (1992). Grammaire du sens et de l’expression. Hachette.
Dia, H. (1979). Ndiaga Mbaye : signe et repère d’une culture. Essai d’interprétation et d’analyse du folklore. Mémoire de maîtrise, Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Diagne, M. (2006). De la philosophie et des philosophes en Afrique noire. Éditions Karthala.
Diagne, S. B. (2002). La leçon de musique. Réflexion sur une politique de la culture. Le Sénégal contemporain. Sous la direction de Momar-Coumba Diop, Karthala, 243-259.
Diop, B. M. (2022). L’afrofeeling : le style musical d’Omar Pène. Les cahiers du GIRCI, 01, 113 – 127. https://girci-ucad.sn/wp-content/uploads/2024/03/8.-Babacar-Mbaye-DIOP.-LAfrofeeling-113-127.pdf.
Diop, M-C. (2002). Savoirs et sociétés au Sénégal. In M. – C. Diop (Ed), Le Sénégal contemporain (pp. 37-90). Karthala.
Donzon, J. P. (2012). Saint-Louis du Sénégal. Palimpseste d’une ville. Éditions Karthala.
Genette, G. (1992). Palimpsestes : La littérature au second degré. Éditions du Seuil.
Lô, F. (Publication le 07/09/2018). https://www.seneplus.com/people/trajectoire-dun-surdoue. (Consulté le 27 novembre 2024).
Mateso, L. (1986). La littérature africaine et sa critique. Éditions Karthala.
Mbaye, C. A. K. (2006). Marsiyya Seex Amadu Kabiir Mbay : entre épopée et hagiographie, Thèse pour le doctorat de 3ème cycle, Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Molinet, E. (2015). La problématique de l’hybride dans l’art actuel, une identité complexe. Le Portique, http:// journals.openedition.org/leportique/2647 =. https://doi.org/10.4000/leportique.2647.
Ndaw, A. (1997). La pensée africaine. Recherche sur les fondements de la pensée négro-africaine. Les Nouvelles Éditions Africaines du Sénégal.
Ndao, C. A. (1993). Création littéraire et liberté. Journal international des écrivains. Ethiopiques, 58, 7-30. https://doi.org/10.7202/1062299ar.
Nketia, K. (1982). Education musicale et prise de conscience culturelle. Educafrica, Bulletin du Bureau Régionale de l’Unesco pour l’Education, 8, 97 – 115. https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000053831_fre&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_98d8c84e-f759-4675-af1c e8b5b4bef6fb%3F_%3D053815freo.pdf&locale=fr&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000053831_fre/PDF/053815freo.pdf.
Niang, M., (30 avril 2024), « Cheikh Abdoul Ahad Mbacké » Mouhamed NIANG Mou Serigne Saliou (Clip Officiel). https://www.youtube.com/watch?v=BFCqMLzchaQ.
Plane, S. (mis en ligne le 10 mars 2017). Dynamique de l’écriture et processus de resémantisation », Pratiques. http:// journals.openedition.org/pratiques/3307
Samba, P. (2014). Musique sénégalaise. Itinérances et vibrations. Éditions Vives Voix.
Samoyault, T. (2005). L’intertextualité Mémoire de la littérature. Armand Colin.
Sangaré, T. (2021). Orchestra Baobab. Une autre histoire du Sénégal. Keewu production, 52 minutes.
Seck, W. (2009), album « Voglio », https://www.youtube.com/watch?v=cJrV0Rcc0nA&list=PLRfTdjatNb2OJ6scZB_9P7Tw7FQyMvWuo&index=7.
Sene, F. K. G. (7 mars 2008). Sénégal : Djibril Gaby GAYE, animateur de radio – La première fois que Kounta Mame Cheikh a chanté en wolof, il a été hué ». Walfadjri. (Consulté le 15 mai 2025).
Sy, M. (2017). Musiques et identités sénégalaises. Revue internationale d’éducation de Sèvres, 75, 97 – 105. https://doi.org/10.4000/ries.5972.
Thioub, I. & Benga, N. A. (1999). Les groupes de musique « moderne » des jeunes Africains de Dakar et de Saint-Louis, 1946-1960. In O. Goerg (Ed.), Fêtes urbaines en Afrique (pp. 211 – 227). Karthala.
Wane, I. (2013). Figures et parures d’une parole : le chant de Ndiaga Mbaye. In A. Keïta (Dir.), Au carrefour des littératures Afrique-Europe (pp. 179 – 194). IFAN-Karthala.
(2019). Esthétique et imaginaire religieux : le wolofal et le suweer du Sénégal. In Baz Lecocq & Amy Niang (Ed.), Identités sahéliennes en temps de crise. Histoires, enjeux et perspectives (pp. 257 – 266). LIT Verlag.