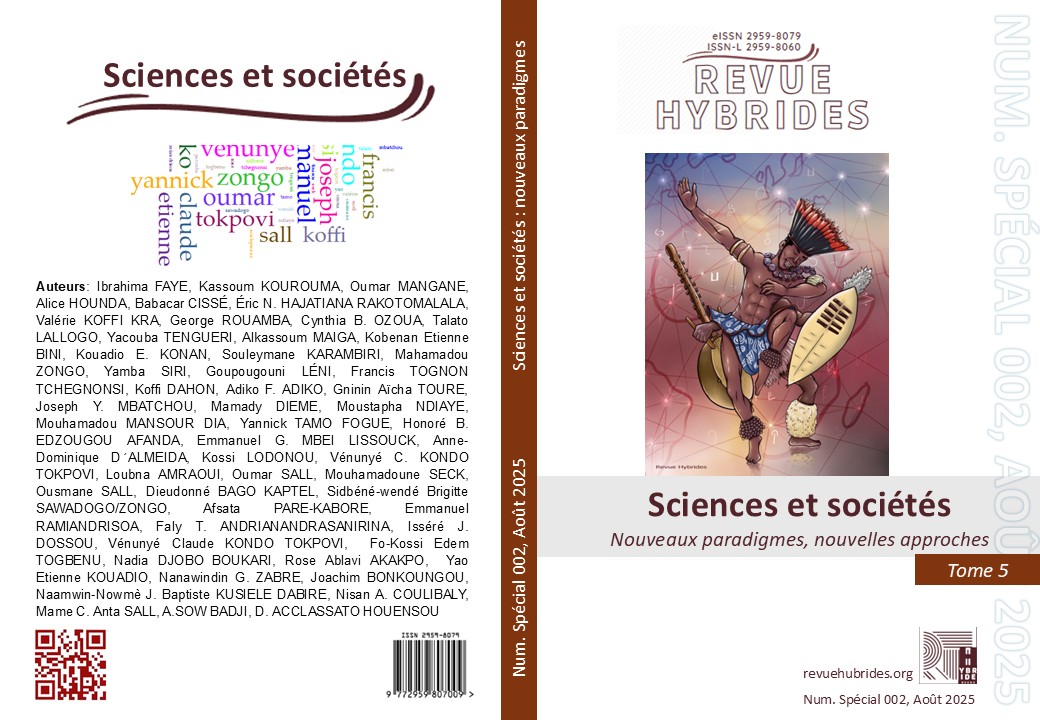Zélé de Papara, the feminist commitment of a piafundia
Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
Email : kassoum77@yahoo.fr
Orcid id: https://orcid.org/0009-0008-8560-057X
Résumé : L’expression « piafundia » désigne la femme stérile ou la femme sans enfant en sénoufo, et il n’est pas courant de formuler un titre à partir de mots empruntés à des langues différentes. En osant le pari, notre intention est de traduire toute la charge négative associée au statut de la femme stérile dans une société où l’enfant est considéré comme la première richesse. Dans ces sociétés, l’idée que la femme stérile participe au développement relève du mythe et c’est précisément dans ce déni que Zélé de Papara a construit sa légende. Le présent article se fonde sur la carrière musicale de cette femme rurale. L’étude établit que la cantatrice développe non seulement une technique particulière de composition qui met à contribution le spectateur, mais aussi que les droits de la femme constituent le fil conducteur de ses chansons. Ce constat permet de présenter Zélé de Papara comme une pionnière du féminisme dans la société sénoufo où le patriciat a longtemps constitué un frein à l’expression de la femme. La méthodologie repose sur la transcription de deux chansons représentatives de l’engagement féministe de Zélé de Papara et les analyses qui en découlent recommandent l’accompagnement communautaire et institutionnel de la nouvelle génération de cantatrices en pays sénoufo.
Mots-clé: Développement, Expression, Féminisme, Patriarcat.
Abstract : The term « piafundia » refers to a barren woman or a childless woman in Senufo, and it is not common to formulate a title with words borrowed from different languages. By daring to take the gamble, our intention is to translate all the negative charges associated with the status of the barren woman in a society where the child is considered as the first wealth. In these societies, the idea that the sterile woman participates in development is a myth and it is precisely in this denial that Zélé de Papara builds her legend. This article is based on the musical career of that rural woman. The study establishes that the singer not only developed a particular composition technique that engages the audience, but also that women’s rights are the common thread of her songs. This observation allows us to present Zélé de Papara as a pioneer of feminism in Senufo society, where patriciate status has long been a barrier to women’s expression. The methodology is based on the transcription of two songs representative of Zélé de Papara’s feminist commitment, and the resulting analyses recommend community and institutional support for the new generation of singers in Senufo country.
Keywords: Development, Expression, Feminism, Patriciate status.
Références bibliographiques
Arnaud, G. & Lecomte, H. (2006). Musiques de toutes les Afriques. Fayard.
Arom, S. & Alvarez-Péreyre, F. (2007). Précis d’ethnomusicologie. CNRS Editions.
Charbagi, H. (2011). Ethnomusicologie. In C. Accaoui (Eds.), Eléments d’esthétique musicale : notions, formes et styles en musique (pp. 105-110). Actes sud/Cité de la musique.
Chouvel, J-M. (2006). Analyse musicale : sémiologie et cognition des formes temporelles. L’Harmattan.
Cote d’Ivoire : Dossier sur l’éducation | International Institute for Capacity Building in Africa Consulté le 13 avril 2025 à 19h12
Coulibaly, S. (1961). Les paysans sénoufo de Korhogo (Côte d’Ivoire). Les Cahiers d’Outre-Mer, (53), 26-59. www.persee.fr/doc/caoum_0373-5834_1961_num_14_53_2192. DOI : https://doi.org/10.3406/caoum.1961.2192
Dioubate, O. (1997). Femmes d’Afrique. Femmes d’Afrique. Syllart Record
Djézou, C. (2021). École pour tous : Le taux de scolarisation des filles demeure faible en Côte d’Ivoire (UNFPA), Fraternité Matin, URL : https://www.fratmat.info/article/215585/societe/eacuteducation/ecole-pour-tous-le-taux-de-scolarisation-des-filles-demeure-faible-en-cote-divoire-unfpa mis en ligne le 18 octobre 2021. Consulté le 22 avril 2025 à 11h56.
Dumas Fils, A. (1872). La question de la femme. Association pour l’émancipation progressive de la femme.
Koné, B. (2020 b). La cantatrice Zélé de Papara, une voix au service de la justice et de l’égalité en pays sénoufo. In Kamaté, B. (Eds.), Droits de l’homme en arts, littératures et sciences humaines en Afrique (1ère Edition, pp. 45-69). Edilivre.
Koudjo, B. (1988). Pour une pédagogie par immersion en Afrique de l’ouest. Vibrations, (n°6), 221-237. URL : www.persee.fr/doc/vibra_0295_6063-1988_num_6_1_1071. DOI : https://doi.org/10.3406/vibra.1988.1071
Laburthe-Tolra, P. & Warnier, J-P. (1993). Ethnologie/Anthropologie. PUF.
Lemaire, M. (2021). Initiations féminines et masculines : parcours sénoufo, parcours d’ethnologues, L’Homme, (239-240) 235-266. https://doi.org/10.4000/lhomme.41230
Nketia, K. (1974). The music of Africa. International Library of African Music.
Ouattara, O.J. (2025). La représentation sociale du musicien de djéguélé en pays sénoufo, Revue Hybrides, (numéro spécial 1), 182-192. https://doi.org/10.5281/zenodo.15123345
Sangare, O. (1996). Denko. Worotan. World Circuit Records.
Scott, C. (1982). La musique : son influence secrète à travers les âges. La Baconnière.
Sékongo, I. (2014). La théâtralité des rites funéraires des nafambélé de Côte d’Ivoire [Thèse de doctorat non publiée, Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan].
Séry, D. (1986). Vers une définition de l’art chez les Bété : le mythe de srèlè. In Wondji, C. (Eds.), La chanson populaire en Côte d’Ivoire : Essai sur l’art de G. Srolou (1ère Edition, pp. 27-41). Présence Africaine.
Soro, K. B. (2021). Le tafal-djéguélé : une pratique et expression culturelle à l’épreuve des mutations sociales. Revue Akofena, 1 (7), 51-64. https://doi.org/10.48734/s7v10521
Zemp, H. (1971). Musique Dan : la musique dans la pensée et la vie sociale d’une société africaine. Mouton.